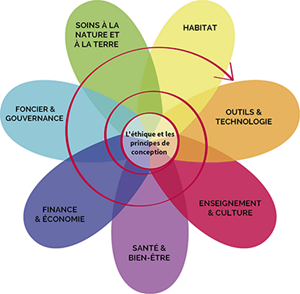Une analyse de Romane MARCHAL, chargée de projets en éducation citoyenne chez Eclosio.
Lire l’analyse en version PDF
Lire l’analyse en version word
Ces dernières années, de nombreux mouvements sociaux se sont organisés pour questionner les rapports de pouvoir qui structurent nos sociétés que ce soit sur les thématiques du racisme, des inégalités sociales, des violences sexistes et sexuelles… Nous avions envie de revenir sur le concept « d’intersectionnalité » de plus en plus mobilisé dans ces mouvements. Dans cette analyse, nous aborderons les origines de ce terme, sa portée politique et sa pertinence dans la compréhension des rapports de domination.
Ces dernières années, nous assistons au déploiement de plusieurs mouvements sociaux qui questionnent les rapports de domination ou rapports de pouvoir (terminologies que nous utiliserons de manière équivalente dans ce texte) et les discriminations qui en découlent. En 2017, dans les luttes féministes c’est le tournant #Metoo, initié par les révélations sur l’affaire Weinstein, il retentit à l’échelle mondiale et libère progressivement la parole de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. En Amérique Latine en 2019, le collectif chilien “Las Tesis” chante leur hymne “El violador eres tu”¹ qui fait par la suite, le tour du monde. Ces mouvements dénoncent le système patriarcal et la violence avec laquelle il oppresse, violente et délégitime la parole des femmes. Parallèlement à ces luttes féministes, le mouvement « Black Lives Matter » reprend de l’ampleur en 2020 lorsque Georges Floyd est tué sous le genou d’un policier blanc. Ce mouvement dénonce le racisme systémique présent aux Etats-Unis, les violences policières, les oppressions racistes…Quels sont les points communs entre ces mobilisations collectives ? Peuvent-elles trouver des points de convergences ? Sont-elles reliées ?
On constate que ces mouvements dénoncent tous deux des oppressions systémiques dans le but d’opérer une transformation sociale. Comprendre les rapports de domination dans le but de construire une société inclusive, équitable et solidaire est un enjeu dont chaque citoyen·ne peut se saisir. Au-delà de la force des mouvements sociaux les réflexions peuvent être amenées dans des lieux tels que les sphères professionnelles, estudiantines ou privées. Pour comprendre au mieux ces rapports de domination, nous allons explorer le concept “d’intersectionnalité”, bien connu dans les groupes militants et dans le domaine des sciences humaines. Nous revenons ici sur le contexte dans lequel il est né, sur sa portée sociale pour ensuite explorer comment « l’intersectionnalité » peut nourrir nos réflexions quotidiennes et servir de porte d’entrée à la construction d’un monde égalitaire. Enfin, nous abordons quelques limites auxquelles il se heurte actuellement.
Origine de ce concept – « Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes et certaines d’entre nous sont courageuses »²
Ce concept d’intersectionnalité nous vient des Etats-Unis et a été théorisé par Kimberlé Crenshaw, militante du black feminism. Elle dénonce à l’époque une invisibilisation des femmes noires dans la société américaine. En tant que juriste, elle constate des discriminations envers les femmes noires dans le contexte du travail. Malgré, les luttes féministes et antiracistes du moment, les femmes noires ne trouvent pas leur place. D’un côté, nous avons des revendications portées principalement par des femmes blanches, qui défendent un féminisme universel invisibilisant les discriminations vécues par les femmes noires. De l’autre côté, nous avons les mobilisations antiracistes qui défendent les droits civiques, portées par des hommes noirs. C’est alors, que le concept “d’intersectionnalité” voit le jour. Kimberlé Crenshaw défend la thèse selon laquelle les femmes noires se trouvent aux intersections des dominations patriarcale et raciale, les comprendre de manière dissociée ne fait pas sens³. “Lorsque ces pratiques présentent l’identité « femme » ou « personne de couleur » sous forme de proposition alternative (ou bien…, ou bien…), elles relèguent l’identité des femmes de couleur en un lieu difficilement accessible au langage.” (Crenshaw, 2005, 53).
Comprendre ces dominations de manière exclusive ne rend pas compte des réalités qui se trouvent aux intersections. Pour Collins, ce concept renvoie alors à « l’idée que « la race, la classe sociale, le sexe, la sexualité, l’ethnicité, la nation, les capacités et l’âge ne fonctionnent pas de manière unitaire et réciproque comme des entités exclusives, mais plutôt comme des phénomènes se construisant réciproquement » (Collins, 2015, 2). L’intersectionnalité nous permet de comprendre les imbrications des différentes discriminations non pas dans une logique d’addition mais bien dans une logique d’intersection. C’est précisément le croisement entre des rapports de domination qui donne lieu à des différences de traitement et des hiérarchies sociales, à un moment donné dans un contexte donné. Les “femmes de couleur se trouvent dans au moins deux groupes subordonnés poursuivant des objectifs politiques souvent contradictoires. Les hommes de couleur et les femmes blanches sont rarement confrontés à cette dimension intersectionnelle particulière de la dépossession qui oblige l’individu à cliver son énergie politique entre deux projets parfois antagonistes.” (Crenshaw, 2005, 61). L’idée portée par Crenshaw est d’insister sur l’importance du discours intersectionnel dans le but de visibiliser les femmes noires dans les combats politiques. Si on considère les deux groupes « subordonnés » (femmes et noirs) comme séparés les uns des autres sans penser leurs imbrications, les femmes noires n’ont pas droit au chapitre. Elles se retrouvent à devoir porter un message féministe majoritairement blanc ou un message antiraciste majoritairement masculin. Par exemple, une des revendications féministes des femmes aux Etats-Unis étaient de pouvoir sortir du foyer en déléguant les tâches domestiques. Ces tâches étaient alors assumées par des femmes noires. Une proposition « émancipatrice » pour les unes se faisait au détriment de la condition sociale des autres et de leur combat pour une répartition du pouvoir.
La remise en question du pouvoir comme boussole…
La question centrale dans les mouvements féministes intersectionnels de l’époque est “Qui détient le pouvoir ? Au service de quel système ?”
Les militantes afro-féministes de la fin du 20e siècle établissent un lien direct entre leurs réalités vécues et le système dans lequel les relations sociales sont hiérarchisées. Bell Hooks4, auteure afro-féministe, contemporaine à Crenshaw, lie le capitalisme aux autres systèmes d’oppressions. Pour elle, l’exploitation économique des noir·es permet de renforcer le système économique et de générer du profit. Angela Davis, dans la même lignée dira que « Pour détruire les racines du racisme, il faut renverser le système capitaliste »5. Elle milite pour abolir les dominations raciales en remettant profondément en question le modèle de production. Modèle où les noir·es sont généralement considéré·es comme de la main d’œuvre à bas prix et exploitables dans les métiers du soin mais également dans les milieux ouvriers. Pour elle, le capitalisme s’est appuyé sur la colonisation pour prospérer et continue de s’inscrire dans des rapports néo-coloniaux notamment dans l’exploitation des ressources naturelles. Pour changer la tendance, il est nécessaire de le remettre en question dans ses principes fondateurs.
Ce lien racisme/ capitalisme peut être fait avec notre contexte actuel. Les usines de production textiles sont délocalisées pour fournir les chaines de vêtements notamment européennes. Par exemple, au Bangladesh, ce sont majoritairement des femmes qui produisent les vêtements dans l’usine. « Les plus grandes marques font désormais fabriquer leurs vêtements dans cet État, car le coût de la main-d’œuvre y est extrêmement bas. »6 Ce qui veut dire que le système économique capitaliste tire profit des dominations patriarcales et raciales en faisant appel à une main d’œuvre bangladeshi7. Dans les politiques de transition écologique européenne, on retrouve de nombreux exemples à l’intersection de la classe et de la race. En matière de recyclage, « la moitié des déchets plastiques collectés en vue d’être recyclés sont exportés afin d’être traités hors de l’Union européenne »8 notamment en Inde, en Turquie et en Egypte. Les voitures trop vielles ou qui sont interdites de circulation dans les pays de l’OCDE sont envoyées sur le continent africain. « L’Afrique a acheté plus de 40 % des 14 millions de véhicules d’occasion exportés dans le monde entre 2015 et 2018. Et la majorité sont entrés sur le continent par les ports du Nigeria, de Libye, de Tanzanie, de Guinée ou du Ghana »9. L’extraction de cobalt en République démocratique du Congo pour nos voitures électriques s’inscrivent clairement dans ces mêmes rapports.10 Ces exemples illustrent la persistance d’inégalités mondiales structurelles qui maintient les travailleur·ses dans une position de subornation (sur base de leur race, leur classe et/ou leur genre et de leurs intersections) et la responsabilité collective que nous portons de tirer profit de ces déséquilibres de pouvoir.
Des militantes afro-féministes actuelles se positionnent dans le débat. Pour Fania Noël, autrice franco-haïtienne et militante afro-féministe, son afroféminisme se situe « dans l’anticapitalisme, le panafricanisme, les politiques migratoires, l’anticarcéralisme… Pas dans les discours sur la citoyenneté et la demande de plus de diversité ». Selon elle, la visée politique initiale de l’afroféminisme a pu être diluée dans la prolifération de « récits individuels de soi » qui dépolitiseraient l’action de base. »11 Dans cet extrait, on saisit l’importance de la politisation des rapports de pouvoir. La démarche intersectionnelle que défend cette autrice franco-haïtienne est la lutte contre des systèmes d’oppressions et non pas une simple revendication de la diversité et la pluralité des récits individuels. Elle nous prémunit du risque de penser que l’intersectionnalité serait une affaire individuelle et que la compréhension de la multiplicité des intersections nous éloignerait de ce que nous partageons en commun. L’intersectionnalité doit être considérée comme une porte d’entrée à ces combats qui se doivent d’être collectifs.
Le pouvoir transformateur de la société?
Questionner les rapports de domination avec une approche intersectionnelle c’est aussi un moyen de questionner les inégalités sociales et la manière dont on les reproduit (Crenshaw, 2005). Il s’agit d’une approche qui nous invite à conscientiser le système politique, social et économique inégalitaire pour ensuite réfléchir à nos pratiques, afin qu’elles soient d’autant plus inclusives. Dans cette optique, ce qui importe avec l’utilisation de lunettes intersectionnelles c’est de questionner le pouvoir et de trouver des points de convergence dans les mobilisations collectives qui pourraient être, par exemple, s’arrêter sur la défense de la « justice sociale » ou la défense de la démocratie participative comme « socle commun » (Collins, Bilge, 2020). La justice sociale remet en question la distribution inéquitable des ressources et permet de dénoncer l’accaparement de celles-ci par une poignée de personnes. Le lien entre l’intersectionnalité et la justice sociale réside dans la volonté de questionner le pouvoir et sa répartition aux mains de quelques-uns. Collins et Bilge abordent également dans leur ouvrage la question de la démocratie participative. « Les vagues de protestation survenues aux quatre coins du monde s’inscrivent dans une forme d’intersectionnalité dans la mesure où elles organisent de multiples groupes opprimés, qui s’engagent dans des luttes pour la justice sociale, dont ils savent la portée potentiellement « transnationale », en affrontant les discriminations et oppressions générées par la répression étatique et le capitalisme néolibéral mondialisé. » (Louli, 2023, 2).
Certaines auteures insistent sur le fait de se (ré)emparer de ce concept « de diverses manières, […] afin qu’il continue être à la fois, non seulement un puissant et labile outil de recherche, mais surtout, un instrument de transformation sociale et politique réelle, capable de modifier les structures profondes des sociétés en même temps que la vie quotidienne. » (Falquet, Kian, 2015, 6). Voilà pourquoi nous trouvions intéressant d’y réfléchir et de nous l’approprier. Falquet et Kian, nous invite à penser nos actions dans une vision plus globale que celle de l’individu. Penser l’inclusivité dans une optique de représentativité est un premier pas, mais la penser au service d’une déconstruction des rapports de domination est d’autant plus pertinente. Si la visée reste au simple fait d’établir un diagnostic de la représentativité d’un groupe minorisé sans pour autant réfléchir aux revendications ou au message que celui-ci porte, alors on tombe dans un piège. On entend ici par « groupes minorisés » des individus qui n’ont pas de pouvoir par rapport à un groupe dominant. Dans les pas de Pierre Bourdieu, on parlera également de groupes « dominés » (dans la relation « dominant-dominé »). Le sociologue Louis Wirth nous en donne une définition générale : une minorité est « un groupe de personnes qui, en raison de leurs caractéristiques physiques ou culturelles, sont distinguées des autres dans la société dans laquelle elles vivent, par un traitement différentiel et inégal, et qui par conséquent se considèrent comme objets d’une discrimination collective (Wirth, 1945, 347) » (Laplanche-Servigne, 2017, 215). Il ne s’agit pas d’une minorité au sens numérique mais bien au sens de partage du pouvoir. Didier et Éric Fassin renforcent cette définition en évoquant que « la minorité […] n’implique pas nécessairement l’appartenance à un groupe et l’identité d’une culture ; elle requiert en revanche l’expérience partagée de la discrimination » (2006, 251).
Selon, ces différentes définitions, le fait d’être une femme dans un système patriarcal marque une appartenance à un groupe minorisé : à travers le monde les femmes partagent le fait d’être discriminées. Lorsqu’une femme porte plainte pour agressions sexuelles, il n’est pas rare qu’elle soit déclarée sans suite. Avec le mouvement #Metoo, on remarque quelques changements dans la légitimité du pouvoir patriarcal, progressivement les femmes reprennent du pouvoir là où elles en étaient dépossédées. D’ailleurs dans les manifestations, certains slogans illustrent un changement dans le regard qu’on pose sur les violences patriarcales : « Victimes, on te croit, agresseur, on te voit ».
Comment appliquer le concept d’intersectionnalité à notre propre réalité?
Le concept « d’intersectionnalité » peut être mobilisé dans de multiples situations ou prises de décision. Par exemple, dans le domaine de la transition écologique, il est primordial de penser le pouvoir et les mesures dans une perspective globale intersectionnelle. Les idées portées dans les mouvements écologistes ont souvent été relayées depuis les classes privilégiées, urbaines. L’intérêt de tout un chacun se trouve dans le fait d’interroger ses propres pratiques pour ne pas reproduire des rapports de domination. Dans notre posture, en tant que citoyen·ne, nous devons être conscient·e de notre appartenance ou non à des groupes dominants et comprendre que nos privilèges sont imbriqués. Par exemple, dans le cadre universitaire, si nous adoptons une lecture intersectionnelle des inégalités sociales, nous verrons qu’une étudiante racisée, fille de parents ouvriers n’aura pas la même position sociale qu’une étudiante non racisée, fille d’universitaire·s. La première subit une double discrimination en raison de sa classe sociale et de sa couleur de peau même si toutes deux partagent le fait d’être une femme et de subir des discriminations sexistes. Si on s’arrête à leur position de femme, on invisibilise les discriminations que vit la première étudiante au vu de sa condition sociale (sa classe) et de sa race. La fille d’universitaires aura plus de moyens pour mener un parcours d’étudiante sans trop d’embuches (tels que les discriminations vécues par ses camarades, le fait de devoir travailler pour financer ses études, etc). Un garçon racisé, aussi fils d’ouvriers, aura également, par rapport à la première étudiante, une position différente. Même si ces personnes partagent toutes deux le fait d’être racisées et d’être issues de la classe populaire, elles ne se trouvent pas du même côté du rapport de pouvoir au niveau de la domination patriarcale. Isoler les vécus de manière individuelle n’a bien entendu pas de sens, le but n’est pas ici de cocher des cases mais bien de saisir l’importance des imbrications et de l’intersectionnalité pour analyser les situations de manière complexe en lien avec leur contexte.
Dans cet extrait, Rokhaya Diallo rappelle la nécessité de prendre les évènements avec une multiplicité de points de vue : « De manière générale, les afroféministes sont sollicitées pour évoquer des questions typiquement raciales. Mais où sont-elles pour aborder l’impact de la non-politique environnementale ? Ou encore de l’impact de la réforme des retraites sur les femmes ? Même durant la crise sanitaire, lorsque l’on parlait notamment des travailleuses essentielles en première ligne, on a manqué de voix afroféministes aux débats. ». (Médiapart, mai 2022, « En France, le difficile chemin de l’afroféminisme »). On voit ici que la mobilisation des noir·es sur un critère unique, en l’occurrence la race, est réducteur et ne rend pas compte de la complexité de leur identité et plus-value pour la société. Leur participation à la vie collective doit s’opérer sur des questions politiques transversales.
Limites du concept
Pour certaines auteures, le danger de l’utilisation de l’intersectionnalité et de sa pratique est de tomber dans « le multiculturalisme néolibéral » (Falquet, Kian, 2015, 6). En effet, comme nous l’avons abordé plus haut, l’intersectionnalité est « née combative, et forcément incomplète, de la nécessité des luttes sociales collectives —souvent féministes, populaires antiracistes et anticoloniales—, hors de l’Université et loin des sujets dominants. » (Falquet, Kian, 2015, 6), se réapproprier cette théorie sans la relier aux systèmes d’oppressions et au déséquilibre dans le partage du pouvoir déformerait le sens même de l’outil. Il ne s’agit donc pas de se cantonner à une simple description identitaire (par exemple : je suis une femme blanche bourgeoise) mais bien d’aller au-delà et de définir les rapports de domination en présence. « En effet, ce que l’approche intersectionnelle examine, ce sont des processus historiques et sociaux, des logiques de production des hiérarchies et des discriminations. Elle s’intéresse donc aux expériences minoritaires (et non pas identitaires), placées au croisement de plusieurs rapports sociaux de pouvoir » (Lepinard et Mazouz, 2021, 27) .
Des auteures telles que Bell Hooks, Crenshaw ou encore Angela Davis privilégient dans leurs écrits, trois axes d’oppressions, à savoir la race, la classe et le genre, c’est ce sur quoi nous nous sommes principalement arrêtées dans cette analyse. Toutefois, des auteures comme Collins élargissent le concept à l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, etc. D’autres vont encore plus loin en abordant la langue, la corpulence, la santé mentale, le logement…12 Ces derniers critères de discriminations sont en débat. En effet, certain·es auteur·es marxistes se posent la question : « Est-ce qu’on lutte contre les expressions des dominations, qui n’en sont que les symptômes, au lieu de s’en prendre au système qui les produit ? » (Koechlin, 2019, 130). Pour illustrer ce propos, prenons la grossophobie13 qui est amenée dans certaines lectures intersectionnelles comme un système d’oppression à part entière. Avec la lecture de Koechlin, la grossophobie est liée aux discriminations qui découlent directement du sexisme. En prenant en compte le système, on voit que la grossophobie n’a pas une portée universelle ce qui nécessite sa remise en contexte. Pour l’accès au logement, c’est la même logique, il existe de nombreuses inégalités (qui pourraient être vues comme un système d’oppression), des personnes sont discriminées, c’est un fait. Dans une logique systémique intersectionnelle, on se posera davantage la question du système de domination sous-jacent (ex : la classe sociale ou l’origine ethnique, etc.).
L’approche intersectionnelle est associée à des mouvements qui bousculent les lignes du pouvoir ce qui donnent place à des contestations et des mouvements réactionnaires. C’est pourquoi, le concept de « wokisme » a pris une grande place sur les plateaux télévisés et les réseaux sociaux. Historiquement, ce terme nous vient des mouvements de défense des droits civiques aux Etats-Unis. Les citoyen·nes afro-américain·es se devaient d’être « woke », à savoir « éveillé·es » aux discriminations et injustices auxquelles ils/elles faisaient face. Aujourd’hui, le terme « wokisme » a largement percolé dans les discours d’extrême droite dont celle-ci s’est emparée pour décrédibiliser les idées progressistes des luttes décoloniales, féministes, LGBTIQIA+, écologistes, intersectionnelles.14 Réfléchir à un modèle de société inclusif, dans le sens large du terme avec une remise en question des rapports de pouvoir, n’est pas un projet porté par tout le monde. Certains, souvent dans une position privilégiée, utilisent alors ce terme dans le but de délégitimer et de réaffirmer leur position de pouvoir. Le terme « wokisme » a laissé la place dans l’esprit populaire et intellectuel à un mouvement qui est celui de l’effacement, aussi nommé la « cancel culture », on ne le relie plus à sa définition initiale qui était celle de l’éveil des consciences aux rapports de domination. Etant donné, qu’il a essentiellement été repris par ses détracteurs, plusieurs mouvements d’actions collectives choisissent de ne pas l’utiliser, nous suivrons également cette ligne bien que nous pensons qu’il soit important de continuer en parallèle à rappeler l’origine du concept.
Une ouverture pour penser les rapports de domination
En conclusion, pour œuvrer à la construction d’une société inclusive, juste, solidaire et durable, l’étude et la déconstruction des rapports de domination sont incontournables. Plusieurs autrices que nous avons évoquées dans cette analyse utilisent le concept « d’intersectionnalité » comme outil d’analyse. Dans les mouvements de mobilisations collectives, il apparait pertinent dans la compréhension des inégalités sociales. Historiquement, ce concept a permis de remettre en question les rapports de pouvoir inhérents à la société américaine des années 1980/90 et de mettre en lumière des oppressions systémiques que subissaient les femmes afro-américaines, dues au fait d’être noires mais également femmes.
A l’heure actuelle, ce concept doit nous permettre d’accompagner notre compréhension des rapports de domination systémiques sans s’arrêter à une simple définition de son identité et tomber dans le piège néolibéral d’une individualisation des problèmes sociaux. Il importe dans nos sphères d’actions qu’elles soient politiques, militantes ou citoyennes, de visibiliser les réalités passées sous silence et d’adopter une démarche critique par rapport à notre posture. L’intersectionnalité nous outille pour mettre en lumière des oppressions systémiques que les personnes non concernées ne vivent ou ne conscientisent pas. Si cela vous intéresse, un outil pédagogique appelé « La marche des privilèges » propose un exercice pour se positionner sur ses privilèges et connaitre sa position dans les engrenages du pouvoir. Plusieurs versions de l’exercice existent, nous avons mis en annexe les questions établies par la fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Ces questions nous permettent d’évaluer notre vécu vis-à-vis des oppressions systémiques et de prendre conscience des différentes imbrications entre ces discriminations. Les afroféministes des années 1990 ont ouvert la voie de la déconstruction des rapports de pouvoir en en faisant un enjeu dans les luttes et les mobilisations collectives. Aujourd’hui, il nous appartient de nous saisir de ce concept non pas dans une simple optique de représentativité mais bien dans une optique de remise en question des systèmes de domination qui perpétuent des inégalités. Dès lors, l’enjeu autour de l’intersectionnalité est de nous unir autour d’objectifs communs tels que la démocratie participative et la justice sociale. (Collins, Bilge, 2020).
Cette analyse non exhaustive avait comme intention de revenir sur les origines du concept « d’intersectionnalité » et de le clarifier. Dans de prochaines productions, il serait intéressant de voir comment ce concept pourrait s’appliquer de manière plus pointue dans différents domaines tels que la transition écologique, la décolonisation, la mise en lumière des violences sexistes et sexuelles, etc.
Notes :
¹ Traduit de l’espagnol celui-ci signifie « Le violeur c’est toi » ; certaines traductions utilisent aussi l’appellation « Un violeur sur ton chemin ».
² Phrase traduite de l’ouvrage de Akasha Gloria Hull, Patricia Bell-Scott et Barbara Smith “All the women are white, all the Blacks are men and some of us are brave”, phrase qui illustre bien le contexte dans lequel l’intersectionnalité est née.
³ Crenshaw est reconnue pour avoir initié ce concept mais plusieurs autrices déjà au XIXe siècle avaient mis cette réalité en avant. Dans le même contexte des années 80, bell hooks et Angela Davis, partagent ces constats et œuvrent également à la visibilisation des femmes noires.
4 Bell Hooks choisit ce nom en mémoire de son arrière-grand-mère, elle le porte volontairement sans majuscule car pour elle, ses idées, ses ouvrages et le projet politique qu’elle défend sont plus importants que son image et la figure qu’elle représente – https://www.babelio.com/auteur/bell-hooks/204236
5 Podcast, France Culture, 01/2017, « Angela Davis : Pour détruire les racines du racisme, il faut renverser le système capitaliste ».
6 Le Monde, 2019, La Lettre de l’éduc. « Blangladesh, l’usine textile du monde », 11/12/2019.
7 Pour approfondir cette thématique de manière didactique, Quinoa, le CNCD 11.11.11. et WSM, ont développé un outil pédagogique « Le jeu de la bobine » qui aborde l’industrie du textile avec un regard sur les systèmes de domination et leurs dimensions intersectionnelles. https://www.cncd.be/Le-jeu-de-la-bobine
8 Parlement Européen, « Déchets plastiques et recyclage dans l’UE : faits et chiffres (infographie) », MAJ 18/01/23
9 Le monde, « L’Afrique est devenue le dépotoir des véhicules dont l’Europe et le Japon ne veulent plus », 26/10/20.
10 Rapport d’Amnesty International de 2016 sur l’extraction du cobalt en RDC, 19/01/16.
11 Médiapart, « En France, le difficile chemin de l’afroféminisme », 22/05/20.
12 Se référer à la roue des privilèges de Sylvia Duck Worth
13 La grossophobie consiste à discriminer les personnes sur base de leur corpulence. A savoir, si elles sont grosses, elles subiront des discriminations (harcèlement, rejet…).
14 Le Monde, « Quatre questions pour cerner les débats autour du terme woke », 23/09/21.
Quelques références pour aller plus loin dans les thématiques…
Podcasts
La poudre, épisode 83, « Penser l’intersectionnalité avec Mame-Fatou Niang »
Kiffe ta race – Rokhaya Diallo et Grace Ly
Girls Power https://www.youtube.com/watch?v=QJD68XYHdzQ
France Culture, (2017), Angela Davis : « Pour détruire les racines du racisme, il faut renverser le système capitaliste ».
Livres
Angela Davis, (1983), Femmes, race et classe, Black Feminism, Anthologie du féminisme américain
Bell Hooks, (1981), Ne suis-je pas une femme ? Femme noire et féminisme.
BellHhooks,(1984), De la marge au centre.
Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, (2019), Féminisme pour les 99 %, La découverte
Collins, P. H., & Bilge, S. (2020). Intersectionality (2nd ed.). Polity Press.
Dorlin, E. (2009). La matrice de la race: Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française. La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.dorli.2009.01
Lépinard, É., Mazouz, S. (2021). Pour l’intersectionnalité. Anamosa.
Mosconi, N. (2010). Christine Delphy. Classer, dominer. Qui sont les « autres » ? Éditions La Fabrique, Paris, 2007, 277 pages. Travail, genre et sociétés, 23, 225-229. https://doi.org/10.3917/tgs.023.0225
Noël-Thomassaint F. (2029), Afro-communautaire : Appartenir à nous-mêmes, Éditions Syllepse, coll. « Arguments et mouvements », 93 p. (ISBN 2849507482, OCLC 1122732027)
Films
« Mariannes noires », Mame-Fatou Niang
« Les nouvelles guerrières », Elisa VDK
Bibliographie
Benelli, N. (2010). Elsa Dorlin : Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination. Nouvelles Questions Féministes, 29, 110-113. https://doi.org/10.3917/nqf.293.0110
Crenshaw, K. (2005). Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur. Cahiers du Genre, 39, 51-82. https://doi.org/10.3917/cdge.039.0051
Crenshaw, K. (2021). Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire du droit antidiscriminatoire, de la théorie féministe et des politiques de l’antiracisme. Droit et société, 108, 465-487. https://doi.org/10.3917/drs1.108.0465
Fassin D. et Fassin É (dir.) (2006), De la question sociale à la question raciale? Représenter la société française, Paris, La Découverte.
Fournier, M. (2006). Les rapports de domination: À propos de La Domination masculine, Pierre Bourdieu. Dans : Régis Meyran éd., Les mécanismes de la Violence: États – Institutions – Individu (pp. 249-252). Auxerre: Éditions Sciences Humaines. https://doi-org.ezproxy.ulb.ac.be/10.3917/sh.meyra.2006.01.0249
Koechlin Aurore. (2019). La révolution féministe, éd. Amsterdam.
Laplanche-Servigne, S. (2017). Chapitre 8 – Les mobilisations collectives des minorisés ethniques et raciaux. Dans : Olivier Fillieule éd., Sociologie plurielle des comportements politiques: Je vote, tu contestes, elle cherche… (pp. 215-238). Paris: Presses de Sciences Po. https://doi-org.ezproxy.ulb.ac.be/10.3917/scpo.filli.2017.01.0215
Lépinard, É., Mazouz, S. (2021). Pour l’intersectionnalité. Anamosa.
Louli, J., (2023), Sirma Bilge, Patricia Hill Collins, Intersectionnalité. Une introduction. Les comptes-rendus
Jaunait, A. (2020). Intersectionnalité : le nom d’un problème. Pouvoirs, 173, 15-25. https://doi.org/10.3917/pouv.173.0015
Soulier, A., Colineaux, H. & Kelly-Irving, M. (2021). Intersectionnalité et incorporation : expliquer la genèse des inégalités sociales de santé: Commentaire. Sciences sociales et santé, 39, 31-41. https://doi.org/10.1684/sss.2021.0190
Falquet J., Kian, A., (2015), Introduction : Intersectionnalité et colonialité, Les cahiers du CEDREF, https://doi-org.ezproxy.ulb.ac.be/10.4000/cedref.731
Ressources en ligne
Amnesty International, Rapport sur l’extraction du cobalt en RDC, 19/01/16, https://www.amnesty.org/fr/documents/afr62/3183/2016/fr/
France Culture, podcast, « Angela Davis : Pour détruire les racines du racisme, il faut renverser le système capitaliste », 22/01/2017, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/angela-davis-pour-detruire-les-racines-du-racisme-il-faut-renverser-tout-le-systeme-capitaliste-5914500
Le Monde, « Quatre questions pour cerner les débats autour du terme woke », 23/09/21 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/09/23/quatre-questions-pour-cerner-les-debats-autour-du-terme-woke_6095681_4355770.html
Le Monde, La Lettre de l’éduc. « Bangladesh, l’usine textile du monde », 11/12/2019, https://www.courrierinternational.com/article/la-lettre-de-leduc-bangladesh-lusine-textile-du-monde
Le Monde, « L’Afrique est devenue le dépotoir des véhicules dont l’Europe et le Japon ne veulent plus », 26/10/20, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/26/l-afrique-est-devenue-le-depotoir-des-vehicules-dont-l-europe-et-le-japon-ne-veulent-plus_6057435_3212.html
Médiapart, « En France, le difficile chemin de l’afroféminisme », 22/05/20, https://www.mediapart.fr/journal/france/200522/en-france-le-difficile-chemin-de-l-afrofeminisme
Parlement Européen, « Déchets plastiques et recyclage dans l’UE : faits et chiffres (infographie) », MAJ 18/01/23, https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-plastiques-et-recyclage-dans-l-ue-faits-et-chiffres-infographie
Outil pour se situer par rapport à nos privilèges – « La marche des privilèges »
La « Marche des privilèges » est un outil qui s’anime en groupe disposé en cercle. Les questions ci-dessous sont citées une par une, chaque fois que vous y répondez par l’affirmative, vous faites un pas en avant. A la fin de l’exercice, vous remarquerez qu’au plus vous êtes au centre du cercle, au plus vous êtes empreint de privilèges qui vous donne du pouvoir. Cet outil existe dans plusieurs versions, nous avons pris ici, une version française qui fait le lien entre les affirmations et le système de domination systémique auquel cela fait référence. Répondre aux questions permet de situer votre propre position sociale dans le but de prendre du recul sur les discriminations que vous subissez ou que vous reproduisez. Testez-le !
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/Livret-Jeux-des-privileges-Commission-LCD-Union-IDF-def.pdf
Lutte des classes et classes sociales
- Mes parents ont fait des études supérieures ;
- J’ai toujours mangé à ma faim ;
- Mes parents ont toujours travaillé ;
- J’ai hérité d’argent ou de propriétés de valeur ;
- Je suis déjà allé·e en vacances avec mes parents à l’étranger ;
- Je suis actuellement propriétaire de mon logement ;
- Je n’ai pas peur d’avoir faim ou de me retrouver à la rue ;
- Je consacre moins de 30% de mon revenu à mon loyer ou crédit ;
- Mon habitation comporte un jardin ou une terrasse.
Sexisme / domination masculine et hétéro-normée
- Je peux marcher seul·e dans la rue à toute heure et dans tous lieux ;
- Je peux me décharger facilement de la responsabilité des tâches domestiques et des soins aux personnes de mon entourage ;
- Mes représentant·e·s élu·e·s politiques sont en grande majorité des représentant·e·s de mon propre sexe ;
- La décision de m’embaucher ne sera jamais basée sur la probabilité que je puisse prochainement souhaiter fonder une famille ;
- Mes humeurs ne seront jamais questionnées selon la période du mois ;
- Les grandes religions sont menées par des personnes de mon propre sexe ;
- Mon/ma partenaire et moi, pouvons-nous montrer de l’affection en public sans peur de regards désobligeants ;
- On ne me demande pas de réfléchir sur ou de défendre mon orientation sexuelle.
Racisme
- Dans ma vie quotidienne, je ne suis pas susceptible de me faire demander « Tu viens d’où ? »
- Je peux voir des personnes partageant mon identité racialisée largement représentées dans les médias ;
- On ne me demande jamais de parler au nom de mon groupe culturel ou religieux ;
- Je n’ai jamais cru que la police m’interpellait en raison de la couleur de ma peau ;
- On ne risque pas d’assimiler mon habilité physique, mon odeur ou ma silhouette à la couleur de ma peau ;
- Je peux sans difficulté acheter des affiches, cartes postales, cartes de vœux, poupées, jouets et magazines pour enfant, représentant des gens de «ma race », appartenance ethnique ou de mon groupe social.
Colonialisme / religion
- Mes parents sont nés en Belgique ;
- Ma langue maternelle est la langue officielle du pays où je vis ;
- On enseigne la culture de mes ancêtres à l’école ;
- Je peux porter des signes religieux en public sans être accusé de ne pas vouloir m’intégrer à la société belge.
Une autre version intéressante existe, c’est celle du « Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine » (CDEACF), elle utilise des fiches personnages plutôt que le vécu des participant·es, ce qui permet de se mettre « à la place de », de se décentrer de son vécu et d’éviter une stigmatisation ou un déséquilibre dans le groupe. https://bv.cdeacf.ca/SCFegalite/ficheActivite2_Marche_de_privileges.pdf